Alfred Ancel (1898-1984), prêtre du diocèse de Lyon (en 1923), responsable général de l’Association des Prêtres du Prado (1942-1971), évêque auxiliaire de Lyon (1947-1973).
Membre de la Commission épiscopale française du monde ouvrier depuis sa fondation en 1950, président de cette commission en 1964 et, une seconde fois, en 1967. Autant dire que le parcours d’Alfred Ancel recouvre largement l’histoire des prêtres-ouvriers dont voici un rapide survol, de 1944 à 1974, en quatre périodes : 1944-1947 ; 1947-1954 ; 1954-1965 ; 1965-1974.
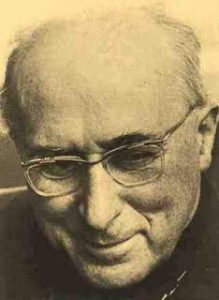
Pour chacune de ces périodes, les contextes ne sont pas précisés afin de ne pas alourdir cet article (contexte économique, politique, social, culturel, religieux, ecclésial), mais cela fait partie de cette histoire et aiderait à la comprendre. De plus, ce survol n’est qu’une partie de l’histoire réelle. Parler de l’histoire des P.O., ce serait dire leur vie ordinaire parmi les gens, dans la classe ouvrière, les milieux populaires, les Églises locales, dire ce qu’ils vivaient, faisaient et pensaient, dire leur quotidien, leurs relations, leur travail, leur militantisme, leurs réflexions, leurs discussions, leurs actes, leurs paroles, leurs spiritualités, leurs prières.
1944-1947 : les premiers prêtres-ouvriers
Au milieu des années 1940 (à partir de 1944 précisément en France) est apparue une petite poignée de prêtres-ouvriers (P.O. en abrégé) en tant que fait collectif. Le premier prêtre diocésain devenu P.O., c’était en Belgique en 1942. Les années 1944-1947 (elles sont parfois trop vite éclipsées) sont le premier acte de l’histoire des P.O.
Les P.O. n’ont pas de fondateur
Personne n’a fondé les prêtres-ouvriers. Personne ne les avait prévus et programmés. Ils ne sont pas apparus tout d’un coup. Ils constituent un mouvement informel. Ils se rejoignent par différents chemins. Les prêtres-ouvriers ne sont pas une invention de l’Église catholique, ils sont une innovation dans le catholicisme. Les années 1940, dans le contexte économique, politique, social, culturel, religieux de l’époque, c’était une période de grande intensité missionnaire, face à la prise de conscience du mur qui sépare l’Église des masses populaires de cette époque, suite au retentissement considérable du petit livre La France, pays de mission ? paru en septembre 1943, écrit par deux aumôniers de la JOC.
Les premiers P.O. vont être une des composantes de ce mouvement missionnaire. Ils ne sont pas les seuls, ce qui pouvait prémunir contre l’autoréférence. Ils sont reliés à des institutions ecclésiales (diocèses, Mission de Paris, Mission de France, Ordres et Instituts religieux). Une précision : dans la Mission de Paris se trouvaient des prêtres venant de divers diocèses et des prêtres envoyés par la Mission de France, sans oublier que des laïcs faisaient partie aussi de la Mission de Paris dès sa fondation et son lancement par le cardinal Suhard en janvier 1944. À Paris, cette année-là, deux prêtres diocésains, venus de province, deviennent P.O. ; quelques autres vont suivre au cours des années suivantes. La nouveauté étonnante de l’existence des P.O. va faire poser beaucoup de questions car elle révolutionne l’image classique du prêtre catholique.
Ancel et Suhard
Alfred Ancel (évêque auxiliaire de Lyon en 1947, à l’âge de 49 ans) était sensible aux initiatives prises par le cardinal Suhard, l’évêque du renouveau missionnaire à Paris. En 1946, Ancel fonde la Mission de la Part-Dieu à Lyon, dans le souci de contribuer à l’évangélisation du monde ouvrier. Il confie cette mission à René Desgrand, prêtre du Prado qui, rapidement convaincu qu’il faut partager la condition ouvrière par le travail, se fait embaucher en 1947. En 1949, il sera rejoint par deux autres pradosiens devenant P.O., Paul Guilbert et Jean Tarby ; A. Ancel favorisera également le passage au travail de Jean Fulchiron et de René Margo.
Ancel avait le souci de l’amélioration des conditions d’existence du peuple de la classe ouvrière. Au moment des grandes grèves de novembre-décembre 1947, il fit paraître une déclaration vigoureuse dans le bulletin du diocèse de Lyon pour attirer l’attention des chrétiens sur la misère ouvrière et le droit aux revendications salariales. Il avait en même temps la préoccupation d’une Église en capacité de rendre possible dans ce peuple la foi en Jésus-Christ et la vie chrétienne. Ancel était certainement proche de Suhard qui aurait même envisagé de le demander comme évêque auxiliaire de Paris. L’un et l’autre avait une vive conscience du mur qui sépare les masses populaires prolétariennes et l’Église.
1948-1954 : vers l’arrêt des P.O.
1947 était une année charnière. Les années 1948-1954, c’est une autre période qui se termine par l’arrêt des P.O. français le 1er mars 1954, par décision hiérarchique venant du Vatican. Dans une situation générale très compliquée, ces années sont délicates à regarder de près, sans faire des envolées lyriques ou idéologiques. Il y a une abondance de documents venant de l’épiscopat, du Vatican et des P.O., mais l’histoire ne se limite pas à des discussions et des relations plus ou moins embrouillées, incompatibles ou tumultueuses entre les P.O. et la hiérarchie de l’Église catholique, ce qui serait une vue réductrice, idéologique et cléricale de notre histoire réelle.
Lettre d’Ancel en juin 1949
Lors du décès de Suhard le 30 mai 1949, Ancel adressa à Gerlier, son évêque cardinal à Lyon, une lettre étonnante, datée du 2 juin 1949, dont voici quelques extraits : « Vous ne pouvez ignorer certains pronostics qui se font à mon sujet, concernant la succession du cardinal Suhard (…). Si jamais vous appreniez que mon nom était mis en avant, je vous serais reconnaissant de faire connaître à la nonciature, avant que l’on ne procède à des démarches plus officielles, certaines objections que je crois, en conscience, devoir exposer (…). » En ayant mis en avant ses « déficiences personnelles », Ancel exprimait ensuite sa conviction que le message d’Antoine Chevrier était une chance de « rénovation spirituelle » pour l’Église. « Si on avait écouté plus tôt le message du Père Chevrier, il me semble qu’il ne se serait pas établi, entre les ouvriers et l’Église, cette barrière qui paraît maintenant infranchissable. La mission du Père Chevrier date de 1856. Elle a suivi de huit ans le Manifeste du Parti communiste. Il y a des rapprochements qui s’imposent (…). » Enfin, après avoir rappelé ses obligations au service du Prado en extension, il révèle pour la première fois à Gerlier un projet très surprenant qui lui tient à cœur : « … J’espère bien que, d’ici quelques années, je pourrai laisser à d’autres la place que j’occupe au Prado. Je pourrais, à ce moment-là, demander au Souverain Pontife la permission de rejoindre nos prêtres travaillant en usine. Ils aimeraient avoir un évêque avec eux. Certes, ils sont heureux de la confiance qui leur est témoignée par la hiérarchie. Mais s’ils avaient un évêque avec eux, leurs camarades ouvriers comprendraient mieux qu’ils sont d’Église. Restant évêque auxiliaire de Lyon, je pourrais à la fois, si je pouvais vivre avec eux, marquer l’unité de l’Église et son établissement dans le prolétariat ». Cette lettre d’Ancel en 1949, c’est tout un programme ! Elle contient ce qui a motivé et constitué son chemin sur terre (voir en conclusion de cet article).
L’organisation des P.O.
En 1949, à l’initiative de la Mission de Paris, les P.O. (ils étaient quelques dizaines) organisent leur première rencontre nationale ; ils constituent un secrétariat informel ; ils décident de se réunir régulièrement au plan national deux fois par an. De 1950 à 1954, il y aura 7 ou 8 rencontres nationales. En 1951, lors d’une rencontre nationale à Lyon, les P.O. s’organisent comme un syndicat (en parlant explicitement de « secrétariat national » et de « commission exécutive ») ; un secrétariat national est donc élu, d’où tel ou tel P.O. est délibérément écarté. Ce positionnement vis-à-vis de l’épiscopat a probablement compliqué les affaires dans le contexte d’une situation déjà difficile où s’accumulaient à l’encontre des P.O. les suspicions, les calomnies, les dénonciations, les incompréhensions et les mises en garde. Dans une situation qui allait devenir de plus en plus alarmiste et critique, il n’était pas facile de vivre la nécessaire et féconde tension entre innovation et institution.
Au cours des années 1948-1954, il faut cependant reconnaître honnêtement et objectivement qu’il y a eu entre les P.O. eux-mêmes (avant 1954, ils étaient environ 130) des différences dans la façon d’envisager la présence, le travail, l’engagement et la mission dans la classe ouvrière et les masses prolétaires. Il y a eu également des questions de leadership qui se sont posées, des nuances qui se sont accentuées pour devenir des différences de fond, des tensions très difficiles à réconcilier. Ces profondes divergences entre P.O. ont été souvent éclipsées par leur résistance commune, leur solidarité, face aux incompréhensions et aux méfiances de la hiérarchie ou aux injonctions du Vatican. Peut-être aussi, les dimensions spirituelles de ce style inédit d’existence sacerdotale ont été plus ou moins éclipsées par l’emprise des idéologies temporelles et théologiques.
Une relation compliquée avec les P.O.
Dans ce contexte, la relation d’Ancel avec les prêtres-ouvriers allait être complexe. Il était cependant très préoccupé par la question de l’évangélisation du peuple de la classe ouvrière (voir sa brochure parue en 1949 L’évangélisation du prolétariat) et il n’était pas opposé au travail ouvrier des prêtres, d’où son intérêt pour l’expérience en cours des P.O. En 1950, Ancel était membre de la commission épiscopale du monde ouvrier. Il lui semblait que les P.O. s’engageaient dans de fausses directions, notamment par l’emprise de l’engagement temporel du prêtre dans le mouvement ouvrier. En accord avec les évêques ayant des P.O. dans leur diocèse, il envisagea un projet de Directoire visant à orienter l’activité des P.O. En 1950-1951, cette affaire de Directoire ayant suscité de multiples réactions et discussions de divers côtés, ce projet controversé, tel qu’il était formulé, n’avait aucune chance d’aboutir vu l’ambiance de ce temps-là. Critiqué, désavoué, se trouvant en quelque sorte disqualifié, ne voulant pas gêner, Ancel s’est mis en retrait au plan national et local, sans se désintéresser des P.O. En effet, il continuait de penser à l’utilité de prêtres travaillant comme ouvriers, envisageant même de « demander au Souverain Pontife la permission de rejoindre nos prêtres travaillant en usine », comme il l’écrivait dans sa surprenante lettre de juin 1949.
Lettre d’Ancel en août 1953
Une lettre adressée au cardinal Gerlier le 12 août 1953 ayant pour objet la fondation d’une « mission ouvrière du Prado » (désignée plus modestement ensuite comme « une communauté pradosienne en quartier ouvrier ») révèle comment Ancel envisageait la réalisation du projet qui avait mûri en lui depuis 1949. « …J’estime que je n’ai pas le droit, en conscience, de permettre à des prêtres du Prado d’entrer dans le monde ouvrier si je ne vais pas avec eux. J’aurais l’impression d’être comme un vicaire apostolique d’Extrême-Orient qui voudrait diriger ses prêtres en restant à Paris… Mes contacts avec l’A.C.O. et avec les paroisses ouvrières, mon appartenance à l’épiscopat et les relations que j’ai eues avec les prêtres ouvriers, ma formation doctrinale et mes études sociales sur la condition ouvrière et le marxisme, me semblent présenter quelques garanties pour un ministère qui sera extrêmement difficile s’il veut être, en même temps, pleinement fidèle à l’Eglise et vraiment présent au monde ouvrier… Je me sens attiré, d’une façon constante et presque invincible, vers la pauvreté et vers les pauvres. Certes, j’ai manqué plus d’une fois de fidélité à cet attrait ; mais j’y suis ramené continuellement. C’est plus fort que moi. Je sens bien que je n’aurais pas la paix, si je prenais une décision qui m’empêcherait de lui être fidèle… » Au moment où Ancel écrit cette lettre, la perspective de l’arrêt des P.O. par décision hiérarchique se faisait de plus en plus précise.
Le choc du 1er mars 1954
Le 1er mars 1954, c’est la date ultime de l’arrêt des P.O. français décidé par le Vatican et mis en application par l’épiscopat français. L’arrêt des P.O. belges date de fin juillet 1955, ils étaient 8 à ce moment-là. Les P.O. français se sont trouvés face à un choix impossible, une décision cruciale : quitter le travail et rester en Église ou rester au travail et quitter l’Église. Des P.O. ont beaucoup hésité, d’autres ont changé de position dans les jours, semaines ou mois qui ont suivi. Ils étaient environ 85-90 la veille du 1er mars, dont 5 pradosiens. Des P.O. avaient arrêté avant ou n’étaient pas directement concernés par l’ultimatum. Une quarantaine de P.O. décide de quitter provisoirement le travail et de rester en Église. Dès 1954, peu à peu, ils s’engagent à défendre ce style de vie sacerdotale, et, en accord avec leurs évêques, ils vont retrouver progressivement un travail ouvrier, tenant plus ou moins compte des conditions restrictives fixées par la hiérarchie pour exercer un travail. Une cinquantaine de P.O. décide de rester au travail et de quitter l’Église. Parmi eux, plusieurs ont ensuite quitté la condition ouvrière pour des carrières professionnelles plus adaptées à leur instruction, leur culture, leurs capacités ; ils se sont mariés avec une amie plus ou moins rapidement ou tardivement. Une vingtaine d’autres, plusieurs étant restés célibataires, ont continué leur engagement dans la condition ouvrière et le mouvement ouvrier.
1954-1965 : l’espoir d’une relance des P.O.
L’histoire ne s’est pas arrêtée en 1954 ni en 1959. La relance des P.O. en 1965 n’est pas arrivée tout d’un coup, elle n’est pas tombée du ciel. Après la décision prise par la hiérarchie catholique d’arrêter les P.O. au 1er mars 1954, il y eut un nouveau coup d’arrêt venu de Rome en juillet 1959. En ces temps-là, ils n’étaient pas nombreux ceux qui croyaient malgré tout à un avenir possible de cette forme d’existence sacerdotale initiée par une poignée de P.O. au cours des années 1940, en France et en Belgique.
Ancel et la période à Gerland (1954-1959)
Dans cette conjoncture très défavorable, Ancel va pourtant réaliser le projet étonnant, qu’il portait au fond de lui depuis 1949, d’aller lui-même vivre d’une certaine manière dans la condition ouvrière. Après avoir demandé et obtenu le 15 juin 1954 « la permission » du Vatican, Ancel, avec quatre autres membres du Prado (laïcs consacrés et prêtres), établit une petite communauté pradosienne dans le quartier ouvrier de Gerland à Lyon, incluant la proximité avec le prolétariat et le partage de la condition ouvrière par le travail, lui-même exerçant une activité d’ouvrier à domicile. Cette communauté inédite durera jusqu’en juillet 1959, au moment de la nouvelle interdiction venant du Vatican. Malgré les limites de cette expérience, c’était quand même quelque chose de totalement inédit comme type d’épiscopat ! Et peut-être aussi, un petit signe d’espoir.
Plusieurs fois, Ancel a témoigné de la grande intensité spirituelle vécue au cours de cette période à Gerland. En 1959, au moment de se conformer à la décision qui venait de lui être signifiée par le Vatican d’avoir à cesser cette expérience (lettre du 27 juillet 1959 adressée au cardinal Ottaviani, un des piliers du Vatican) : « Je crois pouvoir dire que cette période de cinq années a été une des périodes les plus fécondes de mon ministère ». En 1963 (dans le livre Cinq ans avec les ouvriers p.364) : « Je puis bien avouer que j’ai plus appris au point de vue spirituel pendant les cinq années que j’ai passées à Gerland que pendant tout le reste de ma vie sacerdotale ». En 1972 (au moment du 25e anniversaire de son ordination épiscopale) : « Je me rappelle spécialement les années que j’ai passées à Gerland, au milieu des ouvriers, m’efforçant de partager un peu moi-même la condition ouvrière. Je crois que ces années ont été les plus riches et les plus fécondes de mon épiscopat, aussi bien au point de vue spirituel qu’au point de vue apostolique… C’est là que je me suis senti davantage évêque et successeur des Apôtres ». L’arrêt en 1959 de cette expérience ouvrière a certainement constitué pour Alfred Ancel, dans son attachement indéfectible à l’Église, une épreuve spirituelle profonde, un arrachement spirituel éprouvant qui vide de soi-même. On pourrait dire que la vie spirituelle véritable, c’est physique !
Le coup d’arrêt de 1959
L’arrêt des P.O. le 1er mars 1954 était principalement une mesure disciplinaire prise par la hiérarchie épiscopale, tandis que l’arrêt de juillet 1959 se présentait plutôt comme une mesure doctrinale. Le 3 juillet 1959, une lettre émanant du Saint-Office (le bureau doctrinal du Vatican) est adressée à Mgr Feltin, archevêque de Paris, président de la Mission ouvrière, et à Mgr Liénart, évêque de Lille, président de l’Assemblée des cardinaux et archevêques. Ce document interne fut divulgué par le journal Le Monde (15 septembre 1959), et publié par le journal La Croix (16 septembre 1959). Sous forme d’une affirmation doctrinale, cette lettre interdisait aux prêtres toute activité professionnelle salariée, ce qui signifiait l’incompatibilité entre le sacerdoce et la vie ouvrière, entre la vie de prêtre et la condition ouvrière.
Toutefois cette interdiction restera globalement sans effet, comme si le Vatican s’était contenté d’une déclaration de principe. C’est comme si le Vatican avait dit : on interdit, mais on va laisser faire, on laisse contourner l’interdiction, on verra ce que ça donnera. De fait, les P.O. qui avaient retrouvé du travail après 1954 ne l’ont pas quitté. D’autre part, sans recevoir de désaveu, des prêtres, en nombre significatif, prendront une activité salariée, de façon discrète, souvent à temps partiel. Ils envisagent le travail comme un moyen de présence, de proximité et d’apostolat dans le monde ouvrier. Cependant, la question non résolue est celle du travail à plein temps, la vie d’ouvrier, le partage de la condition ouvrière, la possibilité de l’engagement dans le mouvement syndical, les luttes sociales, les mouvements de libération, un engagement temporel qui constituait la principale complication et embrouille entre la hiérarchie catholique et les P.O.
Les initiatives des P.O.
Les P.O. restés au travail à la date du 1er mars 1954 (ils étaient une cinquantaine) se sont considérés et déclarés eux-mêmes en rupture avec l’institution Église. À partir de 1957, quelques-uns ont été à l’initiative d’un groupe constitué de P.O. restés célibataires pour la plupart, engagés dans la condition ouvrière, le travail manuel, le syndicalisme, la fidélité à une vie militante ouvrière quotidienne. De 1957 à 1965, ils ont organisés des rencontres nationales, avec un nombre variable de participants (de 10 à 20), où ils invitaient parfois tel ou tel membre de l’Église institutionnelle. En juin 1964, quinze d’entre eux ont adressé une longue « Lettre aux Pères du Concile ». Plus tard, ces P.O. seront désignés ou se définiront comme des « insoumis », alors que les autres ne se sont pas qualifiés de « soumis ». Pour des motivations diverses en différents milieux, le qualificatif « insoumis » bénéficiera d’une certaine promotion à partir des années 1980.
Plusieurs des P.O. ayant quitté le travail momentanément le 1er mars 1954 ne se sont pas soumis à la décision disciplinaire de la hiérarchie tout en l’acceptant. Au cours des années 1954-1965, leur ténacité va entretenir l’espoir d’une relance, amplifié par la perspective d’un concile. Très vite, une majorité d’entre eux se réunissent, avec quelques évêques, pour entreprendre une réhabilitation de cette façon de vivre le sacerdoce et envisager des délégations à Rome. Pour la plupart, ils retrouvent rapidement du travail dans de petites ou moyennes entreprises, avec l’accord de leur évêque. Ils iront plusieurs fois en délégation à Rome ; une délégation sera enfin reçue par Jean XXIII en février 1960. Fin 1964, il y avait une quarantaine de P.O., la plupart étant de la première génération avant 1954. Pour respecter l’histoire réelle, ne pas en faire une interprétation tendancieuse, romantique ou idéologique, il serait préférable de dire les insoumis en Église et les insoumis hors Église.
Le concile Vatican II
Dans l’Église catholique, cette période est évidemment marquée par l’évènement majeur du concile Vatican II (ouvert le 11 octobre 1962 ; clôturé le 8 décembre 1965). Le 25 janvier 1959, Jean XXIII, élu pape depuis trois mois, avait annoncé son intention de convoquer un concile devant un parterre de cardinaux médusés. Sans considérer la France comme le centre du monde, il faudrait faire un rapprochement entre cette intention de Jean XXIII et le fait qu’il avait été représentant du Vatican en France, à Paris, de fin 1944 à 1953, où il a été témoin de tout ce qui se cherchait au plan apostolique, même s’il était très réservé par rapport aux P.O. Il faut signaler aussi le retentissement considérable de l’encyclique de Jean XXIII « La paix sur la terre », en 1963.
Le 23 octobre 1965, au cours de la dernière session du concile Vatican II, l’épiscopat français, réuni à Rome en assemblée plénière, « se propose, avec l’accord du Saint-Siège, d’autoriser un petit nombre de prêtres à travailler à plein temps dans les usines et sur les chantiers, après une préparation appropriée. Cette autorisation de travail manuel salarié, actuellement très limitée en nombre, est prévue pour une première période de trois ans… Cette initiative relèvera de la responsabilité du Comité épiscopal de la Mission ouvrière, habilitée, au nom de l’épiscopat, à suivre cette première étape. ». Le 7 décembre 1965, à la veille de la clôture du concile Vatican II, le décret sur le ministère et la vie des prêtres est promulgué. Ce décret (chapitre 2, paragraphe 8) mentionne dans les diverses fonctions des prêtres « ceux qui travaillent manuellement et partagent la condition ouvrière ».
Ancel et le concile Vatican II
Alfred Ancel a certainement investi beaucoup de lui-même, de façon humble et déterminée, dans les travaux du Concile Vatican II. En 1964, il était président élu de la commission épiscopale du monde ouvrier (il en faisait partie depuis 1950) et membre du Comité épiscopal restreint des évêques de la Mission ouvrière (institution fondée en 1957). C’est à ce titre qu’il rédige des notes sur le travail des prêtres. Suite aux péripéties d’un Directoire pour les P.O (1950-1951), finalement abandonné, Ancel s’était mis humblement en retrait du collectif des P.O., tout en continuant de croire à cette forme d’existence sacerdotale.
Au moment décisif de la relance des P.O. par l’épiscopat français (1964-1965), on peut penser qu’Alfred Ancel, de façon discrète, en a été probablement un des acteurs déterminants. De plus, comme d’autres évêques du concile, il était motivé aussi par la vision d’une Église servante et pauvre (voir sa brochure L’Église et la pauvreté publiée en 1964). Malgré ses fortes réticences sur l’engagement temporel du prêtre, Ancel ne remettait pas en cause le fait du travail ouvrier pour des prêtres. Dans une lettre de 1978, il exposera, de façon plus nuancée et favorable, ce qu’était devenue sa pensée sur l’engagement du prêtre dans le mouvement ouvrier.
1966-1974 : un nouvel essor des P.O.
1966-1967-1968, c’est « une première période de trois ans » pour le passage de prêtres dans le travail ouvrier, conformément à la décision de l’épiscopat français. La responsabilité directe de cette mise en route est confiée à une « Équipe restreinte » nommée par le Comité épiscopal de la mission ouvrière. Cette équipe est composée de cinq membres prêtres (un animateur officiel ; un P.O. des années 1940 et de la Mission de Paris ; le secrétaire général de la Mission ouvrière ; un responsable de la Mission de France ; un représentant des instituts et ordres religieux).
La mise en route de l’entrée au travail
En 1966, la liste des prêtres autorisés à travailler comme ouvrier se constitua diocèse par diocèse, selon des critères établis par la Mission ouvrière. Dans cette liste officielle, il y avait 52 noms, dont un P.O. d’avant 1954, et parmi eux 8 prêtres du Prado. Ils étaient répartis en une petite quinzaine d’équipes. Plusieurs des 52 candidats avaient déjà trempé dans la vie de travail ouvrier de diverses manières. Pour ce premier envoi, il y avait plus de volontaires que le nombre limité prévu, ce qui a généré des frustrations.
Le 4 octobre 1966, avait lieu pour ces prêtres une dernière session de préparation dans les locaux du séminaire de vocations adultes de Morsang-sur-Orge. Ancel était appelé à y animer la retraite spirituelle. Il commença ainsi : « Je voudrais vous dire ma joie, en vous voyant rassemblés ici. Nous avons beaucoup souffert, nous tous qui, dans le passé, avons dû arrêter notre travail ; mais c’est une joie pour nous et une immense espérance de voir que ce qui a été commencé hier se continuera demain. Sans doute, la manière ne sera pas la même, mais l’élan profond est identique. Nous voulons, par une présence sacerdotale en plein monde ouvrier, lui montrer d’une façon concrète que l’Église tout entière, avec ses laïcs et avec ses prêtres, est avec lui. Nous voulons aussi lui apporter le message du Christ, dans sa totalité certes, mais de telle façon qu’il puisse le comprendre et l’accepter. Présence de signe, présence d’évangélisation, c’est ce qu’ont voulu les premiers prêtres-ouvriers, c’est ce que vous voulez aussi, vous qui allez entrer au travail. La deuxième vague suit la première vague ; c’est le même flot. »
La Mission Ouvrière et les P.O.
Fin 1965, la décision hiérarchique de rendre possible une reprise du travail ouvrier pour des prêtres, c’était un évènement assez surprenant pour les milieux d’Église qui n’y croyaient pas. Cependant, dès la mise en route des nouvelles équipes de « prêtres au travail », de 1966 à 1968, les réactions ont été diverses et durables. Dans le milieu P.O., les uns étaient plus sensibles à la décision hiérarchique de la « reprise », les autres aux conditions de cette « reprise » (des « compromissions » pour certains). D’autre part, plusieurs ressentaient plus que d’autres l’impression d’être sous la tutelle de la Mission ouvrière ; assez vite aussi, les nouvelles équipes se trouvaient à l’étroit dans les dispositifs établis. Même si le principal avait été obtenu (pouvoir travailler comme ouvrier), les fonctionnements mis en place pouvaient apparaître, de façon plus ou moins accentués selon les endroits, comme un encadrement plus qu’un accompagnement. La clarification s’est faite progressivement, accélérée par les évènements de 1968. « Prêtres au travail » était la dénomination officielle adoptée par la hiérarchie, mais ailleurs on continuait à dire « prêtres-ouvriers ».
Malgré un accord établi le 30 mai 1966 entre la Mission ouvrière et la Mission de France, la décision épiscopale de cette mise en route, confiée à la Mission ouvrière, a conduit à des tensions plus ou moins feutrées entre ces deux institutions d’Église, entre des P.O. eux-mêmes, et aussi à une crise interne de la Mission de France en 1969 avec la démission de son Équipe centrale. En 2014, dans le dossier de presse présenté à l’occasion des 60 ans de la constitution apostolique donnée par le pape Pie XII à cette institution d’Église (1eraoût 1954), la Mission de France elle-même rapporte ainsi cette crise interne : « 1965 : Le pape Paul VI autorise le redémarrage des prêtres-ouvriers dans un contexte conflictuel entre la Mission Ouvrière et la Mission de France. 1969 : Le Conseil de la Mission de France donne sa démission. Il eut le sentiment de n’être pas entendu par l’épiscopat sur son rôle prééminent d’instrument missionnaire de l’Église en France. »
Les bouleversements de l’année 1968
Et puis arrive l’onde de choc des mouvements sociaux du printemps 1968 (notamment « le mai des travailleurs »). Cette année-là, à la Pentecôte 1968, il était prévu de faire le bilan des trois premières années, mais, vu les évènements, il est reporté à la Toussaint. Cette rencontre nationale réunissait en un seul collectif les anciennes équipes P.O. insoumis en Église (ceux qui avaient quitté le travail le 1er mars 1954 et avaient repris ensuite un emploi salarié en accord avec leurs évêques respectifs) et les nouvelles équipes envoyées en 1966. À la fin de la rencontre, huit délégués P.O. sont élus à la nouvelle « Équipe Nationale des Prêtres-Ouvriers » (E.N.P.O. en abrégé).
Au cours des années 1969-1973, l’E.N.P.O. va s’orienter vers une équipe autonome composée de P.O. élus par les régions (un par région ou groupe particulier). En 1971, se tenait à Rome un Synode des évêques, avec deux thèmes principaux : le sacerdoce ministériel et la justice dans le monde ; l’E.N.P.O. envoie une contribution qui sera publiée par la Mission ouvrière : « Les prêtres-ouvriers, ce qu’ils vivent, ce qu’ils pensent du sacerdoce ministériel ». En 1973, tout en étant reliée et présente à différentes instances de l’Église en France, l’E.N.P.O. se constitue, pour des raisons pratiques, en Association Loi 1901 (J.O. du 8-9 octobre 1973), le statut canonique de chaque P.O. restant celui de prêtre d’un diocèse ou prêtre de la Mission de France ou membre d’un ordre et institut religieux. Puis, en 1974, l’E.N.P.O. procède pour la première fois à l’élection d’un P.O. comme secrétaire, reconnu comme tel par les instances ecclésiales.
Dans le contexte très particulier d’après 1968, critique face aux institutions, divers courants traversent le clergé français et de nombreux prêtres quittent le ministère. Les années 1969-1974 voient l’arrivée de nouveaux P.O., de plus en plus nombreux au fil des ans, et en même temps l’élargissement de l’implantation géographique (dans les régions, la plupart des départements, les villes petites ou moyennes, l’espace rural). Ils se sont reliés à l’E.N.P.O. dont la préoccupation première n’était pas celle du statut social du clergé et de la transformation institutionnelle de l’Église. La quasi-totalité des P.O. est engagée dans le syndicalisme, soit à la CGT, soit à la CFDT. En 1974, il y aura environ 750 P.O. en France, dont une soixantaine de pradosiens. Et puis, de 1975 à 1985 environ, ce sera, pour ainsi dire, l’apogée des P.O. (nous étions alors nombreux et en pleine forme !), une période aussi où il paraissait juste de ne pas devenir dans l’Église « un corps sacerdotal à part » selon la formule employée en ces temps-là. Dans des proportions moindres, le mouvement P.O. se développe en Belgique, en Italie, en Espagne.
Ancel après le concile Vatican II
Après Vatican II, Alfred Ancel continue de présider la Commission épiscopale du monde ouvrier (la CEMO), il en sera réélu président en 1967. Il fait partie également des cinq évêques composant le Comité épiscopal de la mission ouvrière (le CEMO) qui, le 29 juin 1965, signe l’édito d’un document important à l’époque, le sacerdoce dans la mission ouvrière, établi par le Secrétariat National de la Mission Ouvrière. Le 27 octobre 1968, Ancel est co-signataire avec Marius Maziers d’une Lettre des évêques de la commission du monde ouvrier et du Comité de la mission ouvrière aux catholiques de France. En 1972, c’est une « réflexion de la CEMO dans son dialogue avec des militants chrétiens ayant fait l’option socialiste ».
En 1971, Alfred Ancel est engagé dans la Pastorale des migrants. Au cours des années 1930, il avait déjà porté une attention particulière aux familles italiennes habitant de misérables baraques dans le quartier de Gerland. Dans cette dernière partie de son itinéraire étonnant, il va manifester une grande sollicitude à l’égard des différentes communautés immigrées. Lors des nombreuses réunions auxquelles il participe, il incite les participants à mieux comprendre ce qui se joue au sein des phénomènes migratoires. Les dernières années de sa vie, il sera présent auprès de la communauté maghrébine du quartier de la « Place du Pont », en habitant dans un pauvre appartement d’un vieil immeuble.
Lors du décès d’Alfred Ancel le 11 septembre 1984, Henri Krasucki, secrétaire général de la CGT à ce moment-là, écrivait au cardinal Decourtray, archevêque de Lyon : « Je sais qu’en lui l’homme d’Église se confondait avec sa pensée et ses actes. Je respecte cette vérité. Depuis longtemps, je connais et j’admire l’histoire de sa vie, sa compréhension du monde, des humbles, des opprimés. Celle du monde du travail tel qu’il est et du mouvement ouvrier m’est particulièrement sensible, sans pour autant réduire l’étendue de son œuvre et de sa vision de l’humanité […] Il a été un défricheur de haute stature, ouvrant des voies dont je suis convaincu qu’elles ont un grand avenir » (télégramme du 13 septembre 1984).
La trajectoire d’Ancel a été fidèle à son étonnante lettre de 1949 (voir au début de cet article). Cette lettre était comme une feuille de route, en particulier en faisant un rapprochement audacieux entre la conversion-mission d’Antoine Chevrier à la Noël 1856 et la publication en 1848 du Manifeste du Parti communiste (à cette époque, il n’y avait pas de parti politique ainsi dénommé). Dans cette lettre d’Ancel, on peut déceler : 1- son désir de vivre lui-même en tant qu’évêque dans la condition ouvrière (ce qu’il réalisera d’une certaine façon de 1954 à 1959), sans la prétention d’être un « évêque ouvrier » ; 2- sa conviction que l’existence et le charisme d’Antoine Chevrier, fondateur du Prado, c’est une chance pour la rénovation spirituelle de l’Église, un don gratuit en faveur de toute l’Église ; 3- son attention aux questions sociales, sa présence auprès des classes sociales pauvres, son intérêt pour l’étude du marxisme, son dialogue en vérité avec des militants et responsables communistes ; 4- son engagement indéfectible, fondé sur une intense vie spirituelle, pour une Église ouverte aux populations pauvres.
Quel sera l’avenir de tout ça ?
Le décès d’Alfred Ancel date de septembre 1984, cinq ans avant la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Les années suivantes ont vu l’éclatement de l’U.R.S.S. et l’effondrement des systèmes communistes des pays de l’est européen. On pourrait donc penser que les objectifs d’Ancel sont périmés. D’autre part, l’apogée des prêtres-ouvriers date d’un demi-siècle (les années 1975-1985). Le monde et les sociétés ont considérablement changé, c’est évident, ce n’est pas fini, et il faut s’attendre à de l’inattendu ! L’histoire de la Mission Ouvrière et des P.O. – comme celle de l’Église catho – n’est pas parfaite. Mais il ne faudrait pas oublier ou dédaigner la dimension spirituelle, christique, libératrice, qui depuis les années 1940 animait les préoccupations missionnaires de ces périodes anciennes.
Aujourd’hui comme hier, de nombreuses populations sont exploitées, opprimées, exclues, méprisées, maltraitées, oubliées. Les puissants, les possédants et leurs empires continuent d’imposer leur système de domination. Il y aura toujours besoin de mouvements de libération. Ici, on peut penser à Gustavo Gutiérrez, entré définitivement dans l’éternité le 22 octobre 2024. Il est reconnu comme « le père de la théologie de la libération » qu’il a faite rayonner comme une spiritualité libératrice, ce qui est beaucoup plus révolutionnaire que les théologies progressistes. L’histoire et l’existence de la Mission ouvrière et des prêtres-ouvriers peuvent apparaître comme un des signes du mystère de Dieu incarné qui déborde les Églises. On peut ainsi envisager le christianisme comme un genre ou un style de vie (c’est même le titre d’un livre de Christoph Theobald : Le christianisme comme style) et une insurrection-résurrection de l’humain. On peut également voir le devenir humain comme une question religieuse, théologique, spirituelle très importante. II y aura toujours l’appel, malgré les forces contraires, à servir le devenir humain, faire naître et renaître de la vie, être co-créateurs d’un monde bien et bon dans la foulée du splendide poème de la création en sept jours, en ouverture du récit mythique des origines (Genèse ch. 1 à 11) et de toute la Bible, en adoptant le style Jésus et en étant soufflé par son esprit. Tout un programme !
15 janvier 2025 – Francis GAYRAL, prêtre-ouvrier retraité
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis importants, merci de les signaler au rédacteur de cet article qui les recevra volontiers.
Sources concernant Alfred Ancel
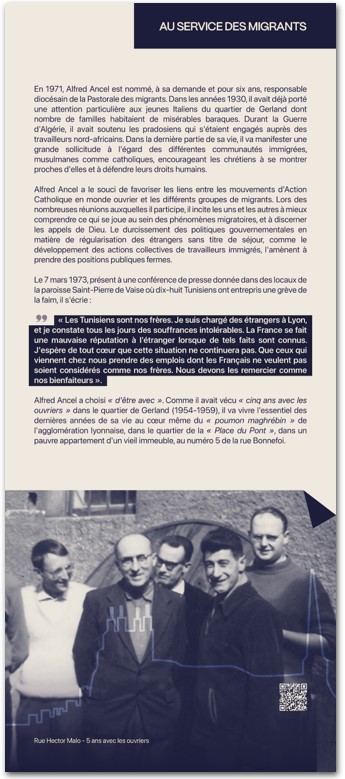
Prêtres du Prado
Questions fréquentes
S'informer